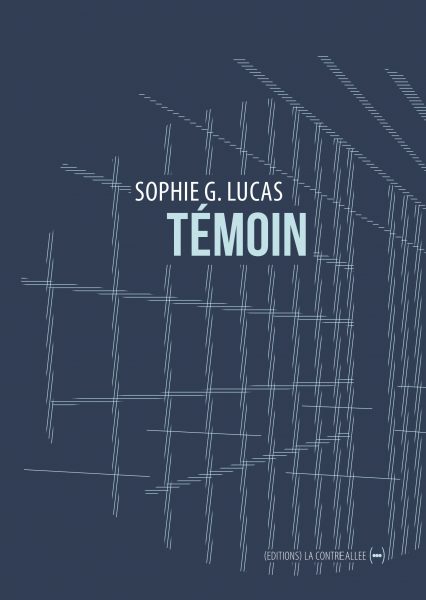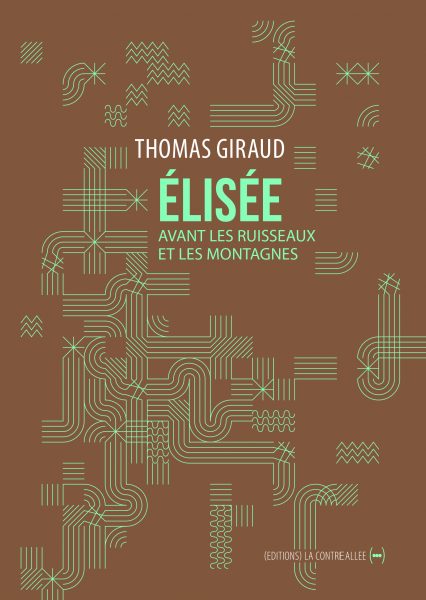Les éditions la Contre Allée
à l'occasion de la parution des livres de Sophie G. Lucas "Témoin", et de Thomas Giraud "Élisée, avant les ruisseaux et les montagnes", octobre 2016
Avec des couvertures aussi colorées que les langues du monde, l’objet attire l’œil et invite les instincts à s’y pencher de plus près. Myriades de formes plus ou moins abstraites, couleurs flashy, ces couvertures parlent. Évoquent. Disent. Elles impactent, et ce n’est que le début. Car bien sûr, à La Contre Allée, la couverture mène à l’ouverture, une ouverture aux sociétés et aux individus d’ici et d’ailleurs, gage supplémentaire de la beauté des livres.
« Délaissant les grands axes, j’ai pris la contre-allée ». Aucun express, Alain Bashung
Bashung, parce que la musique est là, dans la poésie des textes mais aussi dans la vie de l’éditeur de formation musicale. Benoît Verhille crée la Contre Allée avec Marielle Leroy en 2008. Aujourd’hui, la petite maison d’édition lilloise, dont le catalogue est de plus en plus conséquent, compte une équipe de quatre personnes toujours en mouvement et pleine de projets comme des résidences de traducteur avec l’événement D’un Pays l’Autre. Pertinente, la Contre Allée questionne, propose, lance le débat sur un axe éditorial clair : « Mémoire(s) et Société » avec des collections aux airs d’invitations au voyage qui pointent chacune un propos précis ; « La sentinelle », où l’on suit des vies hétéroclites, atypiques, comme celle de Marco Pantani pour Marco Pantani a débranché la prise (2015) : Jacques Josse offre ici une nouvelle biographie de ce génie de la pédale, ce coureur déchu brisé par les drogues ; il y est aussi question de lieux singuliers (le tribunal de Grande Instance par exemple avec Témoin de Sophie G. Lucas qui paraîtra mi-octobre 2016) et de mouvements sociaux et culturels très représentatifs avec Putain d’indépendance ! (2012) de Kaddour Riad : un livre sur le Front de Libération National en Algérie, lors de son accès au pouvoir et de sa proclamation d’indépendance en 1962. « Les périphéries », « Fictions d’Europe », « Un singulier pluriel », trois autres collections aux éditions de la Contre Allée que nous vous invitons à découvrir en un clic !
Anna Fichet, médiatrice de la bibliothèque de la Maison de la Poésie de Nantes. Septembre 2016.
Couverture de « Témoin », de Sophie G. Lucas (La Contre allée, 2016)
Trois questions à l’éditeur, Benoît Verhille :
« On avance mieux avec l’école du doute » avez-vous déclaré à P. Savary dans le Matricule des Anges (mai 2014). Est-ce là quelque chose d’inhérent à votre ligne éditoriale ? Un questionnement perpétuel de la société mais aussi du texte ?
J’ai l’impression que l’on est toujours un peu pressé d’apporter des réponses, non ? C’est rassurant, les réponses, même à l’emporte-pièce…
Pourtant, lorsque l’on a pris le temps de faire le tour de la problématique qui se pose et de l’interroger correctement. De trouver la bonne distance, le bon angle d’approche pour se poser les bonnes questions, cela va tout de même mieux ensuite. Suivent ensuite de possibles réponses, puis enfin, la grande difficulté : le choix. Le nom de la maison a été choisi en pensant à tout cela. Nous voulions qu’il évoque la sensibilité, l’esprit que l’on chercherait à y développer. De la contre-allée, l’on peut porter un regard en oblique sur les grands axes. Le temps du déplacement y est plus lent et nous expose davantage à l’opportunité d’une rencontre. Et les réponses au doute viennent souvent des rencontres, non ? Notre travail nous demande, autant que possible, de créer des conditions favorables à l’expérimentation, de faire en sorte que la recherche de chacun puisse avoir cours. C’est la condition de la création. On observe ainsi le cheminement des auteurs et cela nous aide souvent à davantage de pertinence lors de nos retours sur les textes, le moment venu. Et tout particulièrement là où les usages sont bousculés. Ça peut valoir pour un simple pluriel… C’est bien l’auteur qui fait bouger les lignes, la langue. Pas nous. Qu’elle nous choque parfois, c’est bien normal. C’est même souhaitable. Tout cela nous oblige à nous remettre en cause régulièrement. C’est cela, notre école du doute.
Mais forcément les urgences du quotidien n’apprécient guère et nous rattrapent très vite… Le quotidien, c’est un peu l’ennemi du changement. On lutte difficilement contre le cours des choses. Il y a là une tension permanente avec laquelle nous devons, apprenons à composer. Comme pour un auteur, le choix d’une forme ou de ce qui la renouvellera – ce qui fera système -, est déterminant. C’est politique. Eh bien, en quelque sorte, nous faisons de même. Il nous faut pouvoir nous révolutionner nous-mêmes pour nous adapter et répondre à la situation. Tout cela sans devenir girouette, bien sûr. À La Contre Allée, on a un petit faible pour les textes polyphoniques. Ils cultivent la nuance. Et c’est toujours vers cela que nous devrions tendre en permanence… Imaginez, par exemple, la pauvreté des échanges et de la réflexion au sein d’un hémicycle où il n’y aurait qu’une ou deux tendances représentées … Ce serait comme un système anémié, incapable de se renouveler, de se remettre en cause, assis sur ses certitudes. Non, vraiment, il vaut mieux douter. Cela nous met en mouvement et c’est bien plus créatif.
couverture de « Élisée, avant les ruisseaux et les montagnes », de Thomas Giraud (La Contre allée, 2016)
Votre maison publie des auteurs internationaux (dernièrement l’italien Roberto Ferrucci ou encore l’espagnole Isabel Alba). Qu’est ce qui a motivé ce choix, au départ, de porter un texte et une culture vers une autre, comme le dit la traductrice Anne-Laure Brisac ? Par ailleurs, la Contre Allée c’est aussi des résidences de traducteur/trice. Pouvez-vous nous nous dire ce que cela apporte à votre travail d’éditeur ?
« L’universel, c’est le local moins les murs », nous dit Miguel Torga. Quelques mots qui nous ont beaucoup accompagnés au début. Faire passer, rendre visible, disponible, alimenter le débat, c’est tout de même le cœur de notre métier. Refuser la simplification mais nous attacher plutôt à rendre la complexité du monde. Du monde de chacun et pour chacun… tout cela nous invite fortement à nous ouvrir aux auteurs internationaux, comme vous dites. C’est même une nécessité. En tout cas, c’est une motivation forte, chez nous. Aujourd’hui, il semble difficile de concevoir le fait de vivre à un endroit du globe en ignorant ce qui se passe chez nos voisins proches ou lointains. Ni de chercher à comprendre ce qui nous différencie. C’est bien la seule manière d’avoir une chance de s’entendre. De plus, nous pouvons avoir des problématiques communes mais des façons différentes de les appréhender et de les exprimer. Il nous faut pouvoir en prendre connaissance, de ces façons de voir et de dire les choses différemment, pour nous-mêmes avancer. Il faut que cela circule. Soit en mouvement. Notre travail est aussi d’assurer, d’accompagner ce mouvement.
Cela dit, la maison a été fondée au cœur du quartier de Fives, à Lille. Là où l’Internationale de De Geyter a vu le jour… Ceci expliquant cela peut être… Plus sérieusement, vous évoquez notamment Roberto Ferrucci. Son Venise est lagune, dans une traduction de Jerôme Nicolas, est un bel exemple pour illustrer le sens de notre travail. Son texte fait référence à ces fameux paquebots qui sont synonymes de travail et d’avenir pour la ville de St Nazaire et que l’on retrouve ensuite, une fois sortis du port, à Venise. Là où le simple déplacement de ces écomonstres, comme les nomme Roberto Ferrucci, ébranle les fondations de la ville… Où est le problème ? Dans la construction de ces navires, dans les fragilités d’une ville ou dans l’aberration dans laquelle les dérives d’un système nous plongent ? Au-delà des faits, il y a dans la phrase de Roberto Ferrucci, tous les interstices pour nous aider à méditer sur la question… Mais si le sujet a chez nous toute son importance et que nous sommes particulièrement attentifs au respect et à la diversité des points de vue, nous sommes surtout à la recherche et curieux de leur expression. Le choix d’une forme, un phrasé. Et il y a tout cela, chez Roberto Ferrucci.
Et l’un des enjeux de la traduction est bien là. Rendre accessible, certes, mais surtout rendre la complexité qui fait la singularité de la culture et de la langue de chacun. La reconnaissance du rôle et de l’importance de la traduction reste trop peu valorisée, à notre goût. Les résidences, les rencontres que nous élaborons autour de la traduction sont envisagées dans l’optique d’améliorer cela un minimum. À notre échelle, bien entendu. Puis le contexte politique nous y invite plus que jamais. Les discours sont au repli sur soi, à la simplification… Or nous estimons que c’est tout le contraire qu’il nous faut faire. Et selon nous, la traduction symbolise cela parfaitement. Nous tentons de multiplier les opportunités d’être au contact, d’écouter, des traducteurs nous parler de leur travail. Nous essayons d’avancer en partenariat avec les librairies naturellement, les bibliothèques, mais aussi au sein de l.université, des lycées… C’est une façon de porter le débat, de contribuer à ce qui fait société, là où nous sommes.
Nous accompagnons celles et ceux qui travaillent sur la langue. C’est sensible. Nous tenons plus que tout à ce qui permet à chacun d’évoluer dans le respect et l’intégrité de sa personne. Roberto Scarpinato, un magistrat anti-corruption que nous publions depuis 2011, nous donne et rappelle souvent le cap sur ce point. « Paradoxalement, les institutions devraient garantir le droit à la fragilité des individus. Le droit, en somme, de ne pas renoncer à sa propre humanité… » nous dit-il. Aujourd’hui, être au contact des traducteurs, de leurs visions parfois contradictoires, nous aide à ne pas perdre le cap. À nous ressourcer. Et, encore et toujours, à nous ouvrir. En d’autres régions que la nôtre, le travail vis à vis de la traduction, de celles et ceux qui la pratiquent, est engagé depuis un moment. Ce n’était pas encore vraiment le cas chez nous. Notre catalogue témoigne de l’importance que cela représente pour nous. Nous sommes pleinS d’interrogations sur le sujet et nous avions le souhait de les partager. Cela sous-entend, porter la réflexion au devant du plus grand nombre.
Vous avez pour projet de créer une revue avec des auteurs comme Dominique Quélen, Patrick Varetz, Fanny Chiarello, Carole Fives, Olivia Profizi, Cécile Richard… La revue est-elle le moyen de répondre à une attente et laquelle ? Quel en sera l’axe éditorial ?
Il y a un moment, à force de nous croiser régulièrement lors de rencontres organisées par François-Marie Bironneau, alors libraire au Bateau livre à Lille, un groupe plus ou moins informel a fini par se constituer. Le plaisir de s’y retrouver, de faire connaissance, d’échanger à propos de la rencontre et parfois de la prolonger, … c’était quasiment devenu un rendez-vous. Un journaliste, Geoffroy Deffrennes, qui faisait alors état de la vie du livre dans notre région pour le Point, avait qualifié le groupe « d’école de Lille ». Cela nous avait fait sourire sur le moment mais nous a permis de prendre conscience de ce qui nous rassemblait. Il y a quelques mois de cela désormais, le désir de profiter finalement de la dynamique et des qualités du groupe, d’aller un peu plus loin que nos « rendez-vous », s’est fait ressentir. Le contexte politique n’y est sûrement pas étranger. De là, l’idée d’une revue et d’un premier n° avec pour thème, « Dedans-Dehors ». Moi et Marielle sommes naturellement intéressés pour prendre part et accompagner cette aventure. Et nous le faisons. Cela dit, il reste vraiment encore pas mal de choses à voir avant de pouvoir nous prononcer sur la naissance d’une revue.