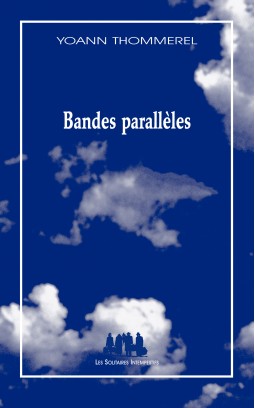Bandes parallèles
Yoann Thommerel, Les Solitaires intempestifs, 2018
Bandes parallèles définit à l’aide de trois histoires une « dramaturgie du télescopage ». Ces trois histoires nous révèlent différentes « actions d’aujourd’hui, plus ou moins politiques, plus ou moins radicales, plus ou moins acceptables, plus ou moins pensées, plus ou moins maîtrisées ». Elles se rencontrent et nous posent une question, celle d’un activisme progressiste politique avec lequel il serait difficile de renouer dans un monde qui en court-circuiterait obstinément son mouvement.
Les raisons de ces actions ne nous sont pas exprimées clairement. Des indices, cependant, apparaissent. Des citations au début des récits en modélisent certains.
« Y’a pas d’ovule dans les testicules »
Frigide Barjot, 24 décembre 2012
« Ladies and gentlemen, we got him »
Paul Bremer, 14 décembre 2003
« Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage »
Loi du 11 octobre 2010
Aussi, c’est par la narration que nous est proposé un regard. Tel que c’est généralement le cas dans l’écriture dramatique, on nous donne uniquement certains éléments clefs. Le contexte est alors davantage soumis à la subjectivité du lecteur selon les éléments qui lui sont cédés. C’est ainsi que notre lecture est floutée. Mais nous lirons quand même jusqu’au bout, peut-être avec les mêmes apparences d’incertitudes et de persévérance que dans les actions des personnages. N’est-ce pas la meilleure manière de poser une question que d’introduire un doute dans la tête du lecteur ?
D’où viennent ces actions ? Quels en sont leurs buts ? Pourquoi semblent-elles si isolées ?
La cagoule, en se présentant dans chaque histoire devient un objet-symptôme. Si elle est symptôme, c’est qu’elle est le signe de quelque chose, comme la fièvre nous prévient d’une maladie. Serait-ce de la possibilité d’agir ? C’est elle qui permet à l’individu, en lui enlevant son visage, d’agir plus facilement, avec davantage de radicalité et de faire de son acte un questionnement, un débat, voire une polémique. Cependant, Yoann Thommerel ne laisse pas cette cagoule à l’abri de son camouflage et la place en première ligne. C’est elle qui influe sur les noms des personnages (en fonction de si elle est portée ou non). C’est elle qui façonne les personnages. C’est alors elle qui compose le mouvement du récit.
Dans ce texte qui défie les genres poétiques et dramatiques, l’interpénétration des histoires et leur chahut provoquent un télescopage entre notre lecture et nos histoires vécues. Bandes parallèles nous ramène à nos actions et interroge nos convictions. Ces « bandes parallèles », éditées aux Solitaires Intempestifs, pourraient sûrement un jour (sur scène ?) faire retentir leur brouhaha.
Joakim Ridel, médiateur de la bibliothèque de la Maison de la Poésie de Nantes
Bandes paralleles
TROIS QUESTIONS À YOANN THOMMEREL
Vous concevez Bandes parallèles comme une comédie, une « comédie du passage à l’acte ». Les actions présentes dans chaque histoire sont plus ou moins achevées. La comédie se dessine-t-elle alors par un court-circuitage de l’action ?
Bandes parallèles est conçu comme un triptyque, trois histoires se succèdent et dans chacune d’entre-elles, des actions sont préparées par les personnages. Il faut distinguer les actions franchement minables préparées dans les duos de personnages des deux premières scènes de celle préparée par la jeune femme de la troisième scène, la scène finale. Ce qu’elle prépare elle est plus poétique, plus lumineux, beaucoup plus puissant aussi, à mes yeux en tout cas. Elle est engagée dans une forme d’action qui peut paraître à première vue dérisoire : elle tricote des milliers de cagoules, des cagoules de toutes les couleurs. Son entourage ne comprend pas le sens de cette action tant elle semble obsessionnelle et maladive. Pourtant, ce qu’elle construit obstinément n’est pas rien, c’est une partition, la partition d’une possible action d’ampleur, une partition collective, celle d’un soulèvement à venir.
Vous avez raison de parler de court-circuitage de l’action, il y a dans toutes les scènes un effet « pétard mouillé », les actions en jeu sont terriblement aberrantes, elles finissent par basculer dans le grotesque. Seule la troisième y échappe à mes yeux, mais l’action ne décolle pas pour autant, elle patine. Ce qui me frappe dans le monde d’aujourd’hui, c’est l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons dès qu’il s’agit de « passer à l’acte ». Les outils de l’action politique classique sont devenus inopérants, des forces réactionnaires vont même jusqu’à se les approprier, elles manifestent avec des pancartes et des slogans, souvenez-vous de la « Manif pour tous ». Terrifiant. Parallèlement, la publicité s’empare de l’imaginaire et du vocabulaire de la révolte. Une grande marque de sport à 3 bandes montrait dernièrement un type au visage agressif, le pied levé, comme s’il s’apprêtait à frapper quelque chose. Un ballon ? Un CRS ? On ne sait pas. L’image est accompagnée du slogan « SÈME LE DÉSORDRE ». On pourrait trouver des milliers d’autres exemples de ce genre de récupération. C’est un trait de notre époque. Comment agir aujourd’hui dans un monde qui s’emploie à systématiquement dévoyer notre héritage progressiste et à désamorcer les moindres sursauts collectifs ? Je n’ai pas la réponse. Dans ma pièce, la jeune femme de la scène 3 en propose une qui se trouve du côté de la création. Avec son installation de cagoules, on peut dire qu’elle tente de desserrer l’étau dans lequel sont comprimés nos imaginaires révolutionnaires.
Vos histoires font toutes appel à des environnements ou des événements liés à des sphères plutôt intimes (enterrement de vie de garçon, rencontre dans un bar, chambre à coucher). Vous posez pourtant la question d’un « activisme progressiste politique » qui englobe alors une sphère plus large de la société. Comment envisagez-vous la relation entre l’intime et le politique ? Comment pensez-vous leur rencontre ?
L’intime est une question qui m’intéresse beaucoup, c’est une notion très mouvante, les jeux d’opposition entre sphère publique et sphère privée, entre l’individuel et le social varient fortement selon les époques et les endroits où l’on se trouve, ce sont des constructions historiques. L’intime de mes personnages, tout ce qui relève de leur intériorité, se construit dans un rapport à l’autre et à l’extérieur. Mais si cette intériorité ne peut être pensée indépendamment du dehors, elle n’est pas pour autant étanche, elle est au contraire très poreuse. Dans la dernière scène de ma pièce, la scène commence dans une chambre d’adolescente, tout y est décrit, le lit, le sol, les murs, etc. Plus tard dans la scène, l’action se déroule dans la même chambre mais les murs ont purement et simplement disparu. On peut dire peut-être de cette disparition des murs qu’elle figure quelque chose comme la rencontre de l’intime et du politique.
Dans l’écriture, je cherche à travailler ces questions de porosités en intégrant notamment dans mes dialogues de longs passages en prose. Une sorte de voix narrative sortie de nulle part et qui n’a a priori rien à faire dans une pièce de théâtre. Elle me permet de densifier mes personnages, de leur donner de l’épaisseur, de proposer des clés d’interprétation permettant de comprendre d’où vient leur violence, d’où viennent leurs entraves, de décrire aussi les dispositifs de pouvoirs dans lesquels ils sont englués, dispositifs qui interagissent avec des questions de genre, de classes sociales, etc.
Vous nous proposez trois histoires. Elles se suivent, se rencontrent et se confondent notamment par même objet : la cagoule. Dans cette forme, Bandes parallèles devient alors une même histoire qui permet de porter la question principale que vous posez. Comment concevez-vous alors ce que vous appelez une « dramaturgie du télescopage » ? Comment se structure-t-elle ? En se définissant en dehors du livre, sur scène par exemple ?
J’ai travaillé là une sorte d’écriture de collage, en rapprochant des scènes sans liens apparents entre elles. C’est leur mise en contact qui raconte quelque chose, dans les jeux de rupture ou d’interpénétration qui opèrent. Ces trois scènes ne peuvent pas exister indépendamment les unes des autres, elles doivent coexister pour prendre tout leur sens. Dans l’économie générale de la pièce, l’objet-cagoule agit comme un connecteur.
Ce télescopage dont je parle, c’est celui du monde dans lequel je vis. C’est quelque chose que tout le monde connaît très bien, au quotidien. Les linéarités sont sans cesse contrariées. Prenons un exemple : vous êtes en train de boire une limonade avec une amie très proche, elle vous parle de son désir pour une fille qu’elle a rencontrée dernièrement au Canada, pendant qu’elle la décrit, vous trouvez dommage que ce désir ne se soit pas plutôt cristallisé sur vous, en même temps vous recevez une notification push sur votre téléphone qui vous annonce un séisme en Indonésie. Votre amie regarde elle aussi son téléphone, il vient de sonner. C’est sa mère qui lui demande où elle a mis les clés de la voiture. En attendant qu’elle finisse son appel, vous allez aux toilettes. Il y a un écran dans le bar. Il diffuse des images d’habitations détruites, ça doit être l’Indonésie. Il y a également un bandeau au bas de l’écran sur lequel défilent des informations : le président de la république a atteint un nouveau record d’impopularité, dans les toilettes, fixé au mur devant chaque pissotière, il y a encore des écrans qui diffusent des spots publicitaires, une pub pour Uber : « Une sortie en famille ? Déplacez-vous sans vous ruiner. » etc. Ce sont ces effets de dislocation et ce rythme saccadé que j’ai voulu saisir dans Bandes parallèles. Cette comédie appelle la scène.